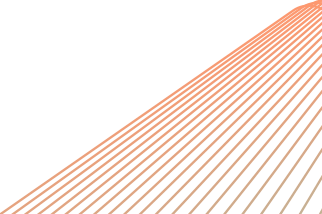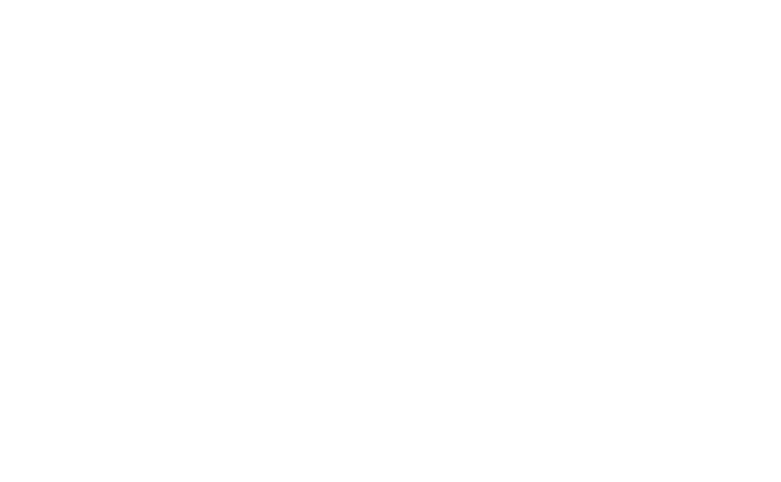LE RWANDA PRÉ-COLONIAL
Le génocide perpétré contre les Tutsi est le résultat d’un acharnement discriminatoire à partir de 1959. Les théories avancées par les européens sur le peuplement rwandais laissaient savoir que les Tutsi seraient originaires d’ailleurs et qu’ils seraient arrivés en dernier lieu. Ils étaient pris pour des conquérants ou es envahisseurs, alors que, selon Antoine Mugesera (Revue d’histoire de la Shoah, 2009/1, no 190, pp.59-60), ce serait vers XIVe et XVIe siècle que l’usage des termes Hutu, Tutsi et Twa auraient commencé à apparaître. En effet, le développement de l’élevage des vaches auraient créé certaines différences dans la vie des Rwandais. Les éleveurs appelés Tutsi (riche), contrairement aux cultivateurs, appartenaient à une catégorie sociale plus aisée et la page était un élément de prestige. En langue Bantoues ( ensemble de langues africaines regroupant environ 400 langues parlées dans une vingtaine de pays de la moitié sud de l’Afrique), Hutu voulait dire « pauvre ». Les nouvelles études stipulent que cette différenciation s’est faite sur place. La profession étant ouverte, chaque rwandais pouvait passer d’une catégorie à une autre. Dans l’imaginaire collectif des Rwandais d’avant la colonisation, il n’y a pas de trace d’une quelconque lutte entre Hutu et Tutsi. Les clans d’appartenances étaient plus importants et les Hutu, les Tutsi et les Twa y appartenaient indistinctement.
LA REPRESSION
Lorsque le vent d’indépendance souffla sur l’Afrique, le Rwanda ne fut pas épargné. Les autorités rwandaise réclamaient l’indépendance, donc, le départ des blancs. Les autorités coloniales se détournèrent donc de l’élite Tutsi pour appuyer les Hutu. Le racisme anti-hutu se transforma en un virulent racisme anti-tutsi. À partir de novembre 1959, la monarchie fut renversée avec l’appui de l’administration belge et de l’église catholique. La violence envers les Tutsi fut inouïe. Les massacres des Tutsi furent systématiques et un grand nombre partit en exil. L’indépendance sera proclamé en 1962 et les Hutu prirent le pouvoir.
LE GÉNOCIDE DE 1994
Le crash de l’avion qui transportait l’ancien président rwandais, dans la nuit du 6 avril 1994, fut le détonateur du génocide. Les massacres ont immédiatement commencé cette nuit à Kigali et se sont vite généralisés dans tout le pays. Selon Claudine Vidal (« les politiques de la haine », Temps modernes, no. 583, 1995), sans une organisation articulée, le génocide n’aurait pris une telle ampleur. Les massacres étaient bien préparés, comportant une certaine hiérarchie et des stratégies bien élaborées. Trois phases ont été observées durant le génocide.
PREMIÈRE PHASE : DU 6 AU 11 AVRIL
DEUXIÈME PHASE : ENTRE LE 12 AVRIL ET LE 1ER MAI
TROISIÈME PHASE : À PARTIR DU 2 MAI
Élimination des Tutsi figurant sur les listes pré-établies. Les noms des personnes visées avaient été distribuées aux groupes qui devaient les tuer. Ces mêmes noms étaient sans cesse lus par la Radio-Télévision Libre des Mille Collines (RTLM) qui encourageait la population à les débusquer. C’était essentiellement des Tutsi nantis, instruits, ou ciblés parce qu’ils travaillaient supposément avec le FPR. Les petits groupes de tueurs allaient aux domiciles de ces personnes ou allaient les retrouver dans leurs cachettes, selon l’information qu’ils avaient reçue. Cette stratégie visait à éliminer en premier les Tutsi ayant les moyens de s’enfuir, de dénoncer ou d’organiser une résistance. Ces massacres visaient aussi les Hutu qui étaient dans l’opposition pour les empêcher de prendre le pouvoir ou de s’opposer à l’exécution du génocide. Après avoir éliminé toutes les personnalités de l’opposition et les Tutsi visibles par leurs moyens ou leur instruction, la voie était libre pour poursuivre les massacres.
L’élimination systématique des Tutsi et dans tout le tuer ceux qui étaient cachés dans les champs de sorgho, dans les marécages, dans les forêts et les bois. C’était aussi l’exécution des massacres dans des lieux où un grand nombre de Tutsi était rassemblé : églises, bureaux administratifs, hôpitaux, stades, etc. Les tueurs se sont livrés aux massacres les plus terribles, assassinant d’un seul coup des centaines, voire des milliers de victimes en l’espace d’un jour ou deux (Aucun témoin de doit survivre, pp. 246-247).
Cette phase suit l’anéantissement des victimes dans leurs lieux de rassemblement et la mise à mort de ceux qui sortaient de leurs cachettes et de ceux qui étaient blessés. Il s’agissait aussi des actes de ratissage sur les collines, dans les maisons désertées, dans les décombres, etc. La population armées par le gouvernement pour la supposée « auto-défense civile » se chargeait de vider toutes les localités de toute présence d’un Tutsi, y compris des bébés ou des malades.